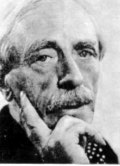|
Le contemporain capital
Texte d'une communication donnée le 26 novembre 2015
au colloque "Paul Valéry aujourd'hui", organisé par Michel Jarrety et
William Marx à la Fondation Singer-Polignac, à Paris.
Lorsque j'ai accepté de participer à ce colloque qui commémore le
soixante-dixième anniversaire de la mort de Paul Valéry, ce fut avec
l'idée que j'allais avoir l'occasion d'évoquer le lien singulier qui
m'attache aux vers délicieusement surannés du poète, lors même que mes
propres choix ou parti pris d'écriture sont tout autres. Mais les
événements hideux du vendredi 13 novembre en ont décidé autrement.
C'est de Valéry penseur que je souhaite tout d'abord parler, notre
contemporain plus que jamais capital, et je devrais ajouter nécessaire,
tant sa personne et son travail s'opposent à toute forme de fanatisme,
et plus généralement d'aveuglement... En choisissant de donner ce titre
"le contemporain capital" à mon intervention, je détournais au profit
de Valéry une formule qu'André Rouveyre avait appliqué naguère à Gide,
mais je n'imaginais pas alors la résonance nouvelle qu'elle allait
prendre...
Il semble en effet que depuis quelques jours, nous ayons plus que
jamais besoin de relire Paul Valéry, et qu'il nous soit devenu encore
plus proche. Pour de nouvelles et terribles raisons, nous partageons ce
sentiment qui fut déjà le sien d'habiter "un monde foudroyé". Je cite
ici son discours de réception à l'Académie française du 23 juin 1927
dans lequel il évoque la disparition brusque du monde de sa jeunesse
dont il ne reste que des ruines : "Nous vivons comme nous pouvons dans
le désordre de ses ruines, ruines elles-mêmes inachevées, ruines qui
menacent ruine, et qui nous entourent de circonstances pesantes (...)
."
Le champ de ruines dont il est ici question est celui que la première
guerre mondiale a laissé derrière elle : ruines morales, ruines
intellectuelles, ruines d'une ingénuité et d'une confiance perdues...
Comment ne pas y songer quand nous avons nous-mêmes aujourd'hui le
sentiment que notre monde familier est en train de périr de "mort
violente" ? Le rapprochement est presque trop facile... Nous pourrions
ainsi multiplier les échos ou les confirmations que la parole de Valéry
trouve dans notre temps.
Est-il nécessaire par exemple de rappeler que dès les années trente,
alors que se profilait le spectre du nazisme, Paul Valéry avait compris
combien les guerres étaient en train de changer de nature.
Pressentant "l'accroissement rapide et fantastique des moyens de
communication et de transmission", il écrivait dès 1929 : "Désormais
quand une bataille se livrera en quelque lieu du monde, rien ne sera
plus simple que d'en faire entendre le canon à toute la terre". Et
comme s'il avait anticipé de façon visionnaire, la sidération des
images diffusées en temps réel par les télévisions, il ajoutait : "On
pourra même apercevoir quelque chose des combats, et des hommes tomber
à six mille mille de soi-même, trois centième de seconde après le coup
."
Conscient des changements d'échelle et des "connexions" nouvelles qui
se multiplient dans ce qu'il appelle désormais "le monde fini" , Valéry
décrit pour la première fois un monde dont toutes les terres sont
connues et toutes les parties se trouvent liées les unes aux autres, un
monde, dit-il, où "toute action désormais fait retentir une quantité
d'intérêts imprévus de toutes parts", et "engendre un train
d'événements immédiats, un désordre de résonnance dans une enceinte
fermée". Ce temps de "solidarité toute nouvelle, excessive et
instantanée, entre les régions et les événements", n'est-ce pas pour
une part, bien avant la lettre, ce que l'on appelle aujourd'hui
"mondialisation"?
***
Mais j'en viens à présent plus précisément à ce qui m'attache à Paul
Valéry et continue de me le rendre proche. Une espèce d'affection
intellectuelle me lie à celui qui depuis la fameuse nuit de Gênes du 4
au 5 octobre 1892 réordonne sa vie mentale et se décide à "répudier les
idoles" qui l'empoisonnent, quelque forme qu'elles prennent. Celui qui
se défie des opinions telles qu'elles se crispent en convictions ou en
croyances. Celui qui entend rester à l'écart des émotions et de
l'irrationnel, de la métaphysique qu'il appelle "astrologie des mots",
"creux aliment d'une faim fausse". Celui qui contre le démon de l'Un
valorise l'association, la relation, la construction, la faculté de
comparer et de lier. Celui qui rassemble tout son être "dans son
attention", et qui fait preuve sur tout sujet d'autant de prudence que
de scepticisme.
L'écrivain Paul Valéry auquel je suis attaché est un homme en alerte
qui a développé très tôt son esprit de contradiction, ce qu'il appelle
lui-même son "antagonisme intérieur". C'est celui qui peut dire "je ne
suis que recherche", et qui applique sur tout objet de
connaissance, à l'instar de son maître Descartes, un doute
méthodique. C'est celui qui interroge sans relâche : Qui suis-je ?
Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je peux ? Qu'est-ce que je puis
vouloir ? Celui qui avoue : " il y a en moi un étranger à toutes choses
humaines, toujours prêt à ne rien comprendre à ce qu'il voit." Celui
qui dit d'abord "je ne comprends pas", puis répond à sa propre
ignorance par une stratégie : "je tourne autour", je serpente,
j'encercle...
C'est celui qui ainsi s'efforce de prendre la mesure du démesuré. Celui
qui endure l'absence, à commencer par l'absence de Dieu, et qui ne
vient ni la combler ni la déplorer. Celui qui exerce son
intelligence, sa vigilance et son ingéniosité pour donner des contours,
des limites, à ce qui n'en a pas. N'est-ce pas cela, la vie de l'esprit
: l'intelligence des limites ?
Oui, c'est peut-être là pour moi la première formule décisive, celle
qui fait du nom même de Paul Valéry une sorte de mot de passe pour la
pensée, le nom d'un accès privilégié à la vie de l'esprit :
l'intelligence des limites, ce qui correspond aussi bien à une
intelligence des possibles soutenue par une expérience des extrémités
de la conscience.
***
Est-ce pour laisser l'homme au milieu d'un désert ontologique, seul et
démuni face à l'absurdité de sa condition que Valéry en vient ainsi à
récuser l'irrationnel ainsi que la plupart des inflexions subjectives
auxquelles les humains se rattachent d'ordinaire et où ils se plaisent
à perdre la tête ? Certainement pas!
Là se vérifie de nouveau à mes yeux l'importance actuelle et capitale
de sa pensée : soupçonneux à l'endroit des Lettres, conscient du
rapport que le langage entretient avec la chimère, Valéry ne désarme
pas, mais valorise le travail qui prête attention aux mécanismes de la
pensée. Il transfère du côté de l'esprit la valeur que les symbolistes
attachaient à la seule poésie. Il se dégage du mysticisme mallarméen,
sans renoncer à l'engagement total qu'il suppose, mais en le déplaçant
du côté de ce que j'appellerais l'obstination de l'intellect.
Paul Valéry vient après Hugo, après Baudelaire, après Rimbaud, après
Mallarmé, c'est-à-dire après les tentatives d'explication orphique de
la terre. Certes, il s'agit toujours de chanter et d'expliquer ce
monde, mais la littérature cesse d'être cette religion qui se prétend
capable d'en pénétrer les arcanes. L'exigence intellectuelle ne faiblit
pas, mais l'enjeu est cette fois le possible, le savoir, l'effort de
tout reprendre, la connaissance réelle de ce qui est humain. J'aime que
Valéry soit celui dont les mains d'écrivain sont à l'instar de celles
du chirurgien "expertes en coupes et en sutures" et qui comme lui
procède, avant toute opération, au "nettoyage de la situation verbale".
La leçon qu'il me paraît délivrer est de lucidité (au sens à la fois de
clairvoyance et de brillance : "l'hiver lucide" disait Mallarmé) aussi
bien que d'attention à la justesse de la langue (dans les deux sens du
mot justesse : ce qui est conforme à son objet, sans excès ni défaut,
et ce qui rend un son juste, conforme aux règles de l'harmonie).
Et c'est là aussi bien ce qui m'attache encore et toujours aux vers
néo-classiques de Valéry : leur beauté formelle et leur apparente
limpidité portent la marque de l'exigence intellectuelle qui les
sous-tend. On se souvient que Valéry demandait à ses vers "la précision
exacte de la prose" : c'est cette précision qui assure leur solidité.
C'est elle aussi qui continue de me les rendre précieux de par leur
résonnance, leur faculté à faire sonner et résonner la langue
française, leur aptitude à faire entendre avec justesse son acoustique
particulière... "J'y suivais un serpent qui venait de me mordre" :
n'est-ce pas, dans une forme racinienne - dont le vers prend soin,
garde mémoire, qu'il donne à réécouter, réentendre- l'intrusion d'un
contenu tout autre, mental cette fois : le drame de l'esprit...
On peut accuser Valéry d'avoir été un poète en gants blancs quand,
l'oreille à Verdun, il polissait les alexandrins raciniens de La Jeune
Parque avec le sentiment de dresser une espèce de digue formelle face à
l'océan du charabia. Que faisait-il alors ? Sinon veiller sur ce qui
pouvait et devait être sauvegardé au milieu des désastres : la langue.
N'est-ce pas là le devoir du poète ? Son métier, sa fonction : prendre
soin de notre langue.
Autant le répéter clairement : je suis attaché à Paul Valéry par le
soin qu'il a su prendre de notre langue. Peu m'importe le caractère peu
ou prou artificiel de ces petits appareils verbaux que sont ses poèmes
dont on pourrait croire qu'ils sont destinés avant tout à la
délectation : leur transparence, leur qualité optique est
incontestable, favorable aussi bien à la juste perception de l'objet
qu'à l'écoute des capacités propres à la langue qui s'y intéresse.
Valéry m'a appris combien l'écriture est une affaire de réglage. Il
appartient au poète, d'abord désireux d'immédiateté, de proximité,
voire de fusion avec l'objet, d'apprendre à régler la distance. Et ce
réglage, précisément, qu'il opère dans la langue, au moyen de ces
petits appareils formels que l'on appelle "poèmes" porte sur la
netteté, les contours, les identités, les similitudes et les
différences. En temps de ruine, d'obscurité et de détresse, dans notre
"aujourd’hui menaçant", le poète ne brandit pas de flambeaux mais
surveille de légers éclairages; il continue de régler la langue pour
l'ajuster à ses objets. Ce faisant, et je cite ici Michel Deguy, il
"neutralise les vues totalitaires ", dément "les assimilations
imprudentes, les identifications intolérantes et meurtrières, et les
exclusions tranchantes jusqu’au sang". Son travail est de résistance à
l'aveuglement.
Alertée de l'émotion et des puissances sidérantes, la poésie telle que
Valéry me la donne à entendre est cet espace de langue où se
manifestent avant tout des valeurs de pensivité et de pondération. Dans
le poème, chaque mot vaut "par l'acte de l'intelligence qui lui trouve
et lui donne un sens". Poésie et pensée sont deux modalités
complémentaires de l'attention au potentiel, aux leurres et aux
limites du langage.
***
Mais il est encore d'autres aspects qui m'attachent à Paul Valéry, tels
que sa distraction, son goût de l'exercice, sa mobilité aussi bien que
son dédain, avoué ou caché, de la poésie des seuls poètes, crispée sur
son pré carré, et veillée par des "censeurs lugubrement monogames".
J'ai comme lui parfois envie de dire de la poésie que "je m'en fous"
(je cite ses mots à Gide), ou qu'elle ne m'importe guère que par les
questions qu'elle me conduit à poser... "Poète" est un mot vaguement
ridicule, et j'aime jusqu'à la manière dont sous la plume de Paul
Valéry le poème lui-même se signale excessivement comme tel, voire se
dénonce comme objet manufacturé surfait. Délibérés, le drapé, la
saturation, la pose de langue ne sont pas réductibles à quelque
archaïsme. Il n'y a pas, comme j'ai pu le croire jadis, deux Valéry :
un poète à l'ancienne et un penseur moderne. Le penseur a déniaisé le
poète qui reprend ou poursuit en connaissance de cause son numéro de
pitre ou de funambule devenu sceptique : Voyez, braves gens, comment
mon désir s'investit dans la langue. Voici ce qu'il y tente et ce qu'il
y peut faire. Pas davantage. Voici, sur le mode de la prouesse, nos
appétits, nos besoins humains et nos leurres...
Déniaisée de tout romantisme, la poésie de Valéry tout à la fois jouit
et se moque d'elle-même. N'oublions pas le congé qui lui a été
brusquement donné une nuit de 1892... Comment, après cela, aurait-elle
pu revenir autrement que comme une modalité de l'attention portée à la
langue ? Jeu avec tout un potentiel de sens et de son, défense et
illustration, jusqu'à la saturation, de ses capacités plastiques ? Par
cette orfèvrerie ironique, Valéry nous rappelle combien la poésie est
narcissique par essence : un poème est un texte qui se mire dans ses
propres reflets.
***
Mais il est un autre aspect qui me conduit au moment de conclure à
relativiser cette image de poète sceptique et qui ne poursuivrait en
définitive son art que dans un mélange de stérilité et d'amertume. Cet
autre aspect, à puissante valeur d'antidote, c'est la sensualité de
Paul Valéry, telle qu'elle irrigue les vers de Charmes, bien sûr, mais
surtout telle que la diffusent les poèmes en prose des Cahiers que
Michel Jarrety a réunis sous le titre "Poésie perdue" et qu'il présente
comme une "trouée de l'affect dans un espace voué à l'intellect". C'est
en vérité ce Valéry-là qui m'a servi de modèle, c'est de lui qu'en y
prêtant garde on pourrait suivre la trace dans mes propres livres. Par
exemple dans Une Histoire de bleu, cette phrase-titre extraite d'une
page des Cahiers sur "la paix du bleu frais peinte sur or" de l'aube
d'été : "La substance du ciel est d'une tendresse étrange ". Ou
l'espèce de contre-épigraphe qui clôt le livre "il y a dans l'amour un
je ne sais quoi de fin du monde". Ou encore, plus profondément, l'écho
dans un chapitre intitulé "Adresse au nageur" de ce beau texte de Paul
Valéry sur la nage que je ne résiste pas au plaisir de vous lire :
"Il me semble que je me reconnais quand je rentre dans cette eau
universelle. Je n'ai rien à voir avec les moissons, les labours; rien
pour moi dans les Géorgiques.
Mais se mouvoir dans le mouvement, agir jusqu'aux orteils, se retourner
dans une masse pure et profonde, boire et souffler de l'eau amère,
fraîche et folle en surface, calme dans sa profondeur! c'est pour moi
le jeu divin plein de signes et de forces où tout mon corps se donne,
se comprend, s'épuiserait. Je saisis l'eau à pleins bras, je l'aime, je
la possède, j'enfante avec elle mille étranges idées. Alors / En elle,
/ je suis l'homme que je veux être. Par elle mon corps devient
l'instrument direct de l'esprit et fait mon esprit. Je m'éclaire par
là. Je comprends à merveille ce que l'amour aurait pu devenir avec moi
si les dieux l'eussent voulu. Excessif du réel. Mes caresses sont
connaissances. Mes actes. - Je ne possède jamais assez. (...)"
Valéry me reste proche, dans cette page comme dans beaucoup d'autres,
en ce que son écriture (qui n'est ici en rien compassée) diffuse à la
fois un modèle de liberté d'allure et d'attention au monde. C'est une
écriture sensuelle et suggestive, propre dans cet extrait à communiquer
les sensations mêmes de la nage. C'est aussi une écriture qui noue
étroitement l'un à l'autre le concret et l'abstrait, la perception et
la réflexion. Qui est donc à la fois lyrique et critique et qui tire de
cette alliance une dynamique particulière. Une aptitude de nageur à "se
mouvoir dans le mouvement" et à brasser tout un potentiel d'existence
et de pensée dans la langue...
Vous m'avez aimablement invité à témoigner de ce qu'a pu m'apporter
l'oeuvre de Valéry, je répondrai que parmi beaucoup d'autres choses
(que je me suis efforcé d'évoquer rapidement), c'est en définitive
cela, cette présence vivante de la poésie et de la pensée, son et sens
mêlés, dans la prose.
|
|